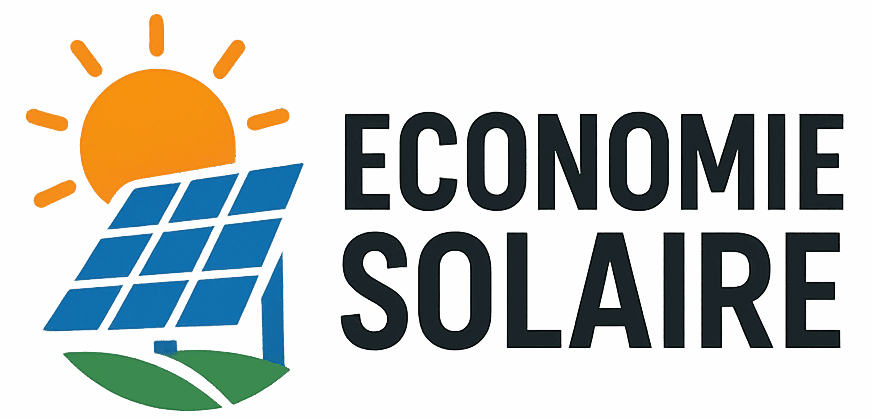Montmorillon a placé l’environnement sous les feux de la rampe lors du conseil municipal du 1er juillet 2025, une séance marquée par des débats vifs et des décisions lourdes de sens pour l’avenir énergétique et urbanistique de la commune. Entre refus tranché des projets éoliens et encouragements ciblés pour le photovoltaïque, la municipalité s’est engagée dans une gestion fine et polémique des enjeux écologiques. Le dossier de l’aménagement des Îlettes, mêlant loisirs et protection des espaces verts, s’ajoute à cette dynamique écologique, témoignant d’une volonté de concilier développement durable et qualité de vie locale. Une ambiance électrique, des choix qui interpellent, et des interrogations sur le modèle énergétique montmorillonnais à l’aube des élections municipales de 2026.
Les éoliennes à Montmorillon : un refus catégorique pour un paysage préservé
À Montmorillon, le conseil municipal s’est montré très clair sur le développement de l’éolien. Dans un climat où les projets d’énergies renouvelables se multiplient partout en France, la commune a pris une position ferme : refus de tout parc éolien sur son territoire. Cette décision, loin d’être anodine, découle d’une analyse approfondie des impacts que ces gigantesques installations pourraient avoir, tant sur le paysage que sur le quotidien des habitants.
L’opposition aux éoliennes repose notamment sur les nuisances visuelles perçues comme envahissantes, ainsi que sur les possibles brouhahas liés au bruit. Ce rejet fait écho au souci constant de préserver l’identité paysagère unique de Montmorillon et de ses alentours pittoresques. L’expérience d’autres régions, où des projets estampillés Enercon ou Vestas ont bouleversé l’équilibre naturel, aurait certainement nourri cette méfiance. Ces sociétés, qui dominent le marché de l’éolien, contribuent certes à la transition énergétique, mais leurs installations ne sont pas toujours accueillies à bras ouverts, surtout quand elles bouleversent des espaces fortement appréciés pour leur beauté.
La décision municipale traduit aussi un paradoxe que beaucoup ignorent : l’éolien, malgré sa place majeure chez EDF Énergies Nouvelles, peut parfois heurter l’acceptabilité sociale locale. Le risque est alors de créer un rejet qui pourrait desservir la cause environnementale globale. Avec ce refus explicite, Montmorillon fait le choix de la prudence mais aussi d’un développement territorial maîtrisé, un signal clair avant les échéances électorales.
Ce virage renforce par ailleurs l’élan vers d’autres formes renouvelables, faisant grimper d’autant plus la pression sur le photovoltaïque, jugé plus discret et adaptable. Pour certains conseillers comme Jean-Philippe Boyard, interrogé longuement sur l’héritage énergétique que la commune laissera aux générations suivantes, le défi est particulièrement épineux. « On parle d’installations sur 30 ou 50 ans, c’est une responsabilité colossale, d’autant plus que la multiplication de ces projets sur tout le territoire régional fait craindre une « invasion » énergétique qui dénature nos terroirs », rappelle-t-il. L’ironie est qu’au lieu de lisser la transformation, le rejet de l’éolien pourrait concentrer les ambitions sur le solaire, avec ses propres complexités.

Photovoltaïque : une grille exigeante pour des projets équilibrés et durables
Montmorillon ne fait pas les choses à moitié lorsqu’il s’agit de sélectionner ses projets photovoltaïques. La création d’une grille d’évaluation extrêmement rigoureuse témoigne d’une volonté manifeste d’encadrer ce secteur en pleine expansion. Avec pas moins de treize critères, totalisant 65 points possibles, cette grille veut garantir que seuls les projets apportant un réel bénéfice, tant écologique que social, seront acceptés. La barre est placée à 35 points minimum, un seuil qui accentue la sélectivité.
Cette approche pragmatique est d’autant plus nécessaire que des acteurs majeurs comme GreenYellow, Photowatt, ou même Schneider Electric, investissent massivement dans le photovoltaïque terrestre et agrivoltaïque. Leur présence impose à la municipalité d’être à la fois ferme et bien informée. Par exemple, dans le cas de la centrale de M. Grosdenier, le score de 46 points montre clairement qu’un tel projet combine emplacement judicieux, faible impact visuel et retombées positives pour la population locale. Pourtant, ce choix n’est pas unanime : des élus comme Reine-Marie Waszak pointent du doigt un désaccord de fond quant à la philosophie de ces installations, dénonçant une approche peut-être trop mécanique et peu en phase avec une vision globale et respectueuse du territoire.
Cette grille n’est pas un simple outil de tri ; c’est un instrument de gouvernance qui incite à penser chaque projet en amont, à mesurer son impact environnemental précis, un peu comme ce qu’implique EDF Énergies Nouvelles dans ses démarches d’intégration paysagère. Ce souci d’harmonie se manifeste aussi dans des initiatives exemplaires ailleurs, où l’on intègre, voire valorise, la biodiversité locale dans le choix du terrain – un aspect indispensable pour éviter de transformer des espaces agricoles ou naturels en zones industrielles désincarnées. Ce que montre notamment l’expérience des parcs photovoltaïques récemment développés en Ardèche ou encore à Pierrelatte.
Enfin, il faut noter que ce filtre strict rend la commune très vigilante à la multiplication à venir des projets solaires dans le département. Une pression renforcée par l’intérêt économique, notamment autour d’acteurs comme TotalEnergies ou Engie, qui investissent lourdement dans le photovoltaïque au sol et l’agrivoltaïque. Ces projets sont souvent présentés comme une évidence dans la transition énergétique, mais le choix du site, l’intégration sociale et la durabilité réelle restent au cœur des débats, poussant Montmorillon à ne pas lâcher sa rigueur réglementaire.
Le réaménagement des Îlettes : un pari pour le développement durable et les loisirs verts
L’aménagement des Îlettes, prévu pour le second semestre, s’inscrit dans une logique de valorisation exemplaire d’un espace naturel emblématique. Au programme, la création d’une coulée verte, la mise en place de nouvelles activités de loisirs et la construction d’une passerelle franchissant la Gartempe. Cette opération illustre une tendance forte : penser l’environnement non comme un frein, mais comme une ressource clef pour inventer de nouvelles manières de vivre ensemble, se divertir et s’ancrer localement.
Offrir aux habitants des loisirs respectueux de l’écosystème local, c’est aussi encourager une prise de conscience collective nécessaire à toute politique écologique réussie. Quel plaisir, par exemple, de profiter de sorties en kayak ou paddle sur la Gartempe, organisées par le CPA Lathus sur réservation, entre le 10 juillet et le 17 août ! Ces initiatives, couplées à un mur d’escalade mobile et du tir à l’arc, relancent le lien entre nature et sport, tout en restant très accessibles, sans transformer le lieu en parc d’attractions à outrance.
Le projet révèle aussi une ambition symbolique : faire des Îlettes un laboratoire où se conjuguent respect du paysage, activités humaines douces et transition écologique. À l’image des opérations menées par Suez en matière d’économie circulaire ou d’Enedis avec ses équipements toujours plus mixtes et innovants, Montmorillon veut montrer qu’il est possible de revitaliser un espace sans renoncer à sa personnalité ni à son authenticité.
Cette démarche est aussi une manière d’anticiper : avec la fixation d’objectifs ambitieux en matière de végétalisation et d’aménagement durables, on crée un modèle intéressant pour les autres collectivités du département. Ce projet bundle un exemple à suivre tant pour la redynamisation urbaine que pour la lutte contre l’artificialisation des sols, enjeu majeur dans cette région très sollicitée.
Valorisation du patrimoine culturel et architectural autour des Îlettes
Au-delà de l’aspect écologique, les travaux du cinéma Le Majestic ajoutent une couche importante à ce programme commun. La rénovation de sa façade, la création d’un hall d’accueil moderne, ainsi que la mise aux normes d’accessibilité incarnent une volonté de mêler patrimoine et modernité. Cela illustre bien comment la transition écologique se double d’une dynamique culturelle, un aspect trop souvent laissé dans l’ombre.
Cette rénovation, dont la fin est prévue pour mi-2026, concrétise aussi l’engagement de la ville à rendre les lieux plus attractifs sans sacrifier l’esprit historique, tout en améliorant le confort et la sécurité des visiteurs. Une approche qui donnerait presque envie de redécouvrir le cinéma en mode « green » !

Des tensions politiques au cœur d’une transition énergétique locale débatée
La séance du conseil municipal n’a pas manqué de moments tendus, notamment lors de l’échange entre Jean-Luc Souchaud, figure de l’opposition, et le maire Bernard Blanchet. L’atmosphère électrique, que certains qualifient de « passe d’armes », rappelle à quel point les enjeux climatiques et environnementaux s’invitent désormais au premier rang des discussions politiques locales.
Le respect mutuel en débat, la volonté affichée par l’opposition d’un dialogue plus posé, n’empêchent pas une vraie divergence de fond sur la direction à prendre pour Montmorillon. L’annonce surprise du maire de ne pas briguer un nouveau mandat en 2026 accentue encore l’incertitude. Les dossiers éoliens, photovoltaïques et d’aménagement urbain se retrouvent alors au centre de campagnes qui s’annoncent passionnées.
Cet épisode met en relief une réalité connue : même dans les collectivités rurales, la transition énergétique bouscule les postures traditionnelles, obligeant les élus à jongler entre croissance, préservation et participation citoyenne. C’est aussi l’occasion de rappeler que la transition n’a rien d’un long fleuve tranquille – surtout avec la montée en puissance d’acteurs majeurs comme TotalEnergies ou Engie, qui façonnent le paysage énergétique national à travers leurs projets locaux.
Le dossier Montmorillonnais illustre parfaitement comment un territoire peut se positionner entre scepticisme face à certains types de renouvelables et portage affirmé d’autres solutions. Ce débat dense nourrit assurément une réflexion plus large sur le rôle que doivent jouer les communes françaises dans ce défi global, à l’heure où les modèles énergétiques s’écrivent en temps réel.
Passionné par les énergies renouvelables, j’ai 27 ans et je consacre ma carrière à promouvoir l’énergie solaire. Mon objectif est de rendre cette source d’énergie propre accessible à tous, tout en contribuant à la protection de notre planète. Je crois fermement en un avenir durable et en l’innovation technologique pour y parvenir.