Saint-Martin-de-Coux : la préfecture met fin au projet énergétique photovoltaïque
Un coup de théâtre en pleine Haute-Saintonge ! La préfecture vient de refuser le permis de construire pour un projet de centrale photovoltaïque de 5 hectares à Saint-Martin-de-Coux, suscitant à la fois un grand soulagement et beaucoup de débats au sein de cette petite commune rurale. Face à des inquiétudes fortes autour de la préservation du paysage, l’arrêt de projet est accueilli comme une victoire par de nombreux riverains, notamment par l’association locale Sauvegarde de la Sausière qui bataillait depuis plus d’un an contre ce développement solaire. Ce refus met en lumière les tensions parfois complexes entre développement des énergies renouvelables et protection de l’environnement et du cadre de vie dans les territoires ruraux.
Pour mieux comprendre ce dénouement, il faut saisir les différentes facettes du projet et l’environnement dans lequel il s’inscrivait. Le site retenu pour cette future ferme solaire se trouve sur un terrain agricole au lieu-dit La Sausière, non loin du cœur du village où vivent près de 500 habitants. Ce parc aurait été un investissement de 9,50 millions d’euros porté par l’entreprise française Reden, un acteur bien implanté dans le secteur photovoltaïque. Fondée il y a une quinzaine d’années, cette société se distingue par la gestion d’une capacité totale du gigawatt sur plusieurs centaines de sites, en France et à l’étranger. Pourtant, malgré ce profil professionnel, tout le monde ne voit pas le développement solaire de la même façon dans ce coin de la Charente-Maritime.
De nombreuses voix se sont élevées contre le projet, de riverains notamment, craignant pour la valeur de leurs biens et la perte de leur paysage vallonné si précieux. Le Conseil municipal, la Communauté de communes de Haute-Saintonge, ainsi que la Commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (Cdpenaf), avaient aussi exprimé leur opposition. C’est donc sous la pression de nombreuses alertes et réflexions partagées que le préfet a pris, au mois d’août 2025, la décision de refuser le permis de construire.
Le scénario à Saint-Martin-de-Coux n’est pas sans rappeler d’autres cas similaires où la cohabitation entre projets photovoltaïques et zones rurales soulève des débats passionnés. Des exemples ailleurs en France montrent bien que l’implantation d’une centrale solaire au sol n’est jamais un dossier simple et qu’il faut savoir trouver un équilibre entre écologie, paysage et acceptabilité locale. Pour comprendre ce phénomène à un autre niveau, on peut consulter des enquêtes de terrain sur les centrales photovoltaïques qui démontrent les enjeux aussi bien techniques qu’humains de ces projets.

Les enjeux environnementaux et le cadre territorial au cœur du refus de la préfecture
Il faut creuser un peu pour saisir pourquoi une collectivité pourtant friande d’initiatives vertes peut tourner le dos à un ambitieux projet d’énergie solaire. À Saint-Martin-de-Coux, le contexte rural est très sensible. Ce territoire est marqué par des paysages agricoles typiques de Haute-Saintonge, caractérisés par des vallons verdoyants, des haies bocagères et un habitat dispersé. L’arrivée d’une immense étendue de panneaux, même à but écologique, risquait de transformer radicalement ce tableau. Au-delà de la simple vue, c’est une question plus profonde de préservation des sols agricoles, du corridor écologique et de la qualité de vie locale qui s’est posée.
Un arrêté préfectoral porté par ces préoccupations ne se contente pas de refléter un refus catégorique de l’équipement solaire, il oblige aussi à examiner le mode de développement de la transition écologique dans les espaces ruraux. Passer du discours aux actes environnementaux, c’est aussi mesurer l’impact d’une infrastructure énorme sur la biodiversité locale, sur le drainage des terres ou encore sur la nuisibilité visuelle et sonore pour des habitants parfois très vulnérables. Des rapportages de riverains contre des centrales photovoltaïques montrent combien ces préoccupations sont souvent au premier plan, alimentant la crainte d’un dérèglement dans des zones tranquilles.
La décision finalement prise en août 2025 s’appuie aussi sur les recommandations de la Cdpenaf, une structure protectrice qui veille à éviter la multiplication des équipements de surface au détriment des terres dédiées à l’agriculture productive. On retrouve ce dilemme dans plusieurs régions rurales où le photovoltaïque au sol entre en friction avec la vocation historique des sols agricoles. Ce refus symbolise un arbitrage délicat entre ambitions énergétiques nationales et spécificités locales. Il rappelle qu’une transition énergétique réussie passe aussi par un dialogue territorial record et un respect scrupuleux des usages du territoire.
Si ce refus surprend certains acteurs du secteur solaire, il insiste surtout sur la nécessité d’avancer avec des projets maîtrisés, intégrés dans des stratégies globales dont la prise en compte des habitants et de leur environnement est la pierre angulaire. Cela pointe vers une future émergence plus forte de solutions alternatives comme l’agrivoltaïsme, qui combine l’énergie solaire et l’agriculture sans empiéter trop brutalement sur les paysages.

Les réactions locales : entre opposition déterminée et espoir d’un modèle énergétique respectueux
Les réactions des habitants et des associations environnantes sont souvent les véritables indicateurs de la réussite ou de l’échec d’un projet énergétique. À Saint-Martin-de-Coux, l’association Sauvegarde de la Sausière s’est imposée comme un acteur clé dans la mobilisation contre la centrale. Depuis son annonce au début de l’été 2024, cette association a fédéré les riverains, multiplié les démarches administratives et consulté toutes les instances susceptibles d’émettre un avis.
Cette mobilisation est l’expression d’un attachement fort à la qualité de vie locale et au patrimoine naturel. Dominique Petit, président de l’association, a exprimé son intense satisfaction lors de l’annonce du refus préfectoral. Ce n’est pas qu’une victoire symbolique : c’est une reconnaissance sensible que la transition écologique ne sacrifie pas forcément les territoires ruraux. Leur combat rappelle aussi que toute implantation de projet énergétique doit s’accompagner d’un dialogue social et d’une transparence totale tout au long du processus.
Cela n’enlève rien aux défis majeurs que posent les ambitions solaires. Car, si l’installation d’une centrale photovoltaïque au sol modifie profondément le paysage, elle apporte aussi un appui crucial dans la réduction des gaz à effet de serre et la diversification des sources d’énergie. La tension est palpable, et c’est pourquoi les alternatives comme l’intégration de panneaux en toiture ou des projets hybrides sont de plus en plus valorisées, comme mis en lumière dans des cas d’agrivoltaïsme conciliant ruches et brebis.
Le tissu associatif local, renforcé par cette expérience, pourrait ainsi devenir un interlocuteur de poids pour de futures initiatives qui sauraient allier transition écologique et respect du cadre de vie. Cette vigilance citoyenne est un moteur puissant pour penser des projets territoriaux enfin inclusifs, respectueux des paysages, et porteurs d’énergie propre.
Le rôle de Reden Solar dans le contexte photovoltaïque régional et les perspectives d’avenir
Reden Solar, promoteur du parc photovoltaïque, est une figure incontournable du secteur solaire en France. Fort d’une présence sur près de 800 sites et d’une capacité totale d’un gigawatt, ce groupe incarne l’essor de l’énergie solaire dans l’Hexagone. Implanté historiquement dans le Lot-et-Garonne, il emploie plus de 250 salariés répartis dans neuf pays, représentant une expertise technologique et une puissance d’investissement conséquentes.
Son ambition à Saint-Martin-de-Coux, avec un projet chiffré à 9,50 millions d’euros, traduit un souhait d’ancrage dans la transition énergétique locale. Celle-ci vise à fournir une énergie renouvelable décarbonée dans un contexte où chaque watt produit compte. Mais ce projet, aussi impressionnant soit-il, a rencontré la réalité incontournable des dynamiques territoriales. L’entreprise doit maintenant composer avec un refus qui laisse une porte ouverte à un éventuel recours devant le tribunal administratif, possible jusqu’au 1er décembre 2025.
C’est à ce moment précis que se dessine le vrai enjeu : comment les acteurs du solaire vont-ils s’adapter quand les projets au sol sont de plus en plus contestés ? L’avenir passera sans doute par une diversification des approches, en insistant sur la cohabitation entre agriculture et photovoltaïque, ou bien en développant des centrales plus compactes sur des zones délaissées, comme les toitures, les friches industrielles, voire des infrastructures linéaires.
Reden, qui a déjà inaugué plusieurs centrales en France, comme par exemple dans la région de Buzancais, est sans doute bien placé pour relever ce défi. La clé sera d’anticiper les débats et d’instaurer des projets pensés conjointement avec les élus locaux et les riverains pour éviter les tensions et garantir une acceptabilité sociale plus durable. Ce n’est qu’à cette condition que la transition écologique, indispensable, pourra se faire en harmonie avec le territoire rural et ses habitants.
Perspectives pour la transition écologique en Haute-Saintonge après l’arrêt du projet photovoltaïque
Avec cette décision de la préfecture, la Haute-Saintonge s’inscrit dans une logique de transition écologique attentive à ses spécificités territoriales. Ce refus ne freine pas l’ambition globale de développement des énergies renouvelables dans la région, mais invite à des projets mieux calibrés, moins invasifs et plus en phase avec les attentes des communautés locales.
La sauvegarde des territoires ruraux comme Saint-Martin-de-Coux rappelle à tous qu’il ne s’agit pas seulement de produire de l’électricité verte mais aussi de protéger un cadre de vie précieux pour ces petites communes. Cette dynamique passe par un dialogue renforcé entre porteurs de projets, autorités, habitants et associations. L’émergence d’outils participatifs et de concertations publiques plus fréquentes permettront de limiter les conflits et de valoriser des solutions innovantes et respectueuses.
Dans ce contexte, les expériences françaises récentes, à l’image des projets d’appel à la participation active des populations dans les centrales photovoltaïques, ouvrent de nouvelles voies prometteuses. Il est possible d’imaginer une évolution où l’énergie solaire s’intègre dans le paysage de manière sensible et responsable. La Haute-Saintonge, en refusant ce projet dès aujourd’hui, pourrait devenir un exemple régional en matière d’équilibre entre transition énergétique et environnement rural.
À long terme, il s’agit surtout de réaffirmer que la transition écologique sera d’autant plus réussie qu’elle respecte la diversité des territoires. Ceux-ci, loin d’être de simples emplacements, sont des lieux chargés d’histoire, de vie, et d’attachement. Le respect de ce tissu permet de renforcer l’acceptabilité, sans laquelle aucun projet, aussi vertueux soit-il, ne peut avancer sereinement.
Passionné par les énergies renouvelables, j’ai 27 ans et je consacre ma carrière à promouvoir l’énergie solaire. Mon objectif est de rendre cette source d’énergie propre accessible à tous, tout en contribuant à la protection de notre planète. Je crois fermement en un avenir durable et en l’innovation technologique pour y parvenir.
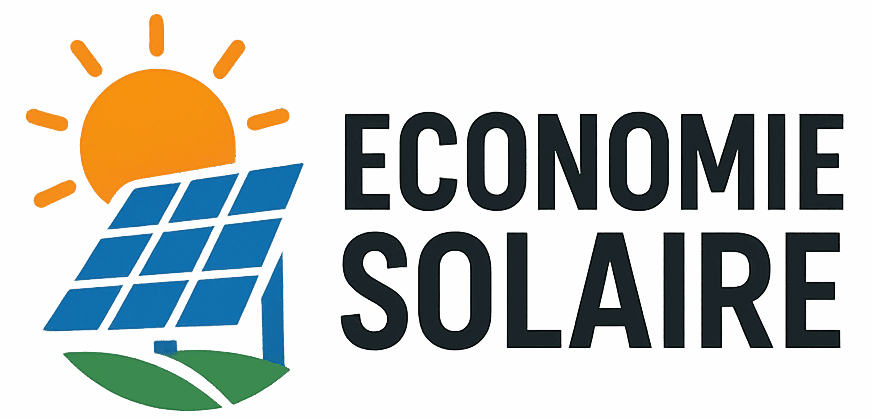

Bonjour Paul,
Votre développement est tout à fait intéressant.
Il est juste dommage que personne ne prenne attache auprès de la famille.
Certes, il y a une société porteuse du projet, mais il y a également un couple d’agriculteurs!
Cinquième génération de paysans, qui grâce à leur travail ont façonné ce paysage.
Aujourd’hui, une association menée par un néorural, arrivé dans la région depuis seulement 4 ans, s’octroie une victoire.
Mais quelle victoire ?
Celle d’être tranquillement dans sa piscine pendant que les propriétaires suent à grandes gouttes pour que la prairie soit verdoyante!
Celle de promener son chien dans cette nature, alors que leur souhait est de pouvoir y faire pâturer leurs vaches!
C’est entendu mais difficilement acceptable!
Bien cordialement,
La famille de paysans