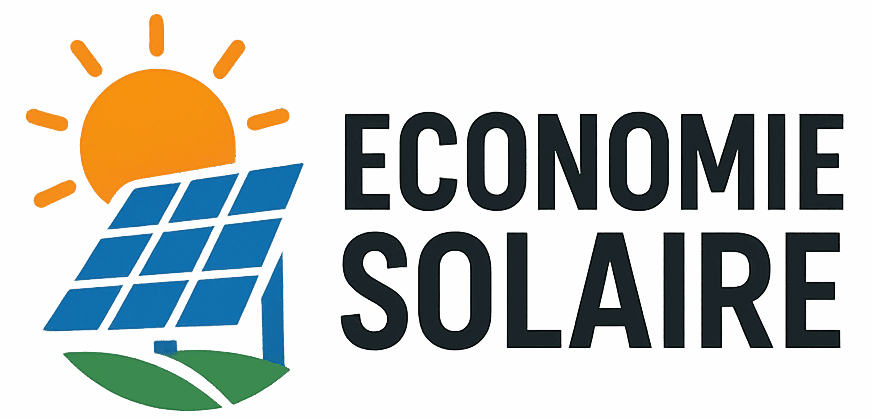Au sud de Bordeaux, un projet solaire titanesque pourrait bien révolutionner le paysage énergétique français : la ferme photovoltaïque Horizeo, annoncée comme la plus vaste d’Europe. Avec ses 820 mégawatts de puissance prévue sur 680 hectares, ce méga-parc promet d’alimenter plus de 600 000 habitants. Pourtant, derrière cette ambition impressionnante, l’ombre du blocage réglementaire plane depuis plus d’un an. La loi Zéro Artificialisation Nette (ZAN), qui restreint drastiquement la taille des centrales solaires en forêt à seulement 25 hectares, freine ce chantier majeur. Engie et Neoen, maîtres d’œuvre du projet, maintiennent que 2026 reste jouable, mais l’absence de décision politique pèsera lourd. Pendant que des mastodontes solaire germaniques, portugais et espagnols avancent à toute vitesse, l’Hexagone hésite, entre urgence climatique, protection de la forêt des Landes de Gascogne et volonté industrielle.
Horizeo : un mastodonte énergétique au cœur de la forêt girondine
La promesse d’Engie et Neoen pour Horizeo est tout simplement colossale. Imaginez une installation photovoltaïque capable de générer 820 MW, cela représente un parc solaire plus puissant que beaucoup de centrales nucléaires régionales françaises. Sur 680 hectares, autrefois massivement boisés dans le massif des Landes de Gascogne, ce parc pourrait couvrir l’équivalent de près de 1 200 terrains de football ! Pour mettre les choses en perspective, la puissance annoncée permettrait d’alimenter plus de 600 000 personnes, une avancée majeure dans l’indépendance énergétique locale et nationale.
Pourtant, ce projet titanesque patine. Autorisations en suspens depuis février 2024, enquête publique jamais lancée : tous les feux sont au rouge pour l’instant. Et ce parce que la loi Zéro Artificialisation Nette (ZAN) interdit la destruction de plus de 25 hectares de forêt pour ce type d’installation, ce qui met l’ambition énergétique en conflit direct avec la préservation environnementale. La commune de Saucats, où le parc devrait voir le jour, alerte sur la consommation foncière : Horizeo occuperait presque la moitié de l’espace disponible dans le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) local, un chiffre qui explique la controverse qui enfle.
Engie et Neoen ne lâchent pas l’affaire. En avril 2025, la directrice générale d’Engie, Catherine MacGregor, a exprimé sans détour leur impatience face à ce blocage. Sans dérogation politique rapide, le projet pourrait être abandonné, malgré le soutien local et les millions déjà engagés. Ce cri d’alarme résonne alors que des géants comme EDF Renouvelables et TotalEnergies investissent massivement dans des centrales de taille plus modeste mais en cours de réalisation à travers le pays, soulignant qu’avec une meilleure législation, la France ne serait pas à la traîne.

Enjeux environnementaux sous haute tension
Il serait aisé de considérer Horizeo uniquement comme un défi technique ou économique, mais la dimension écologique est incontournable. Le massif des Landes de Gascogne est l’une des plus grandes étendues forestières d’Europe, un habitat unique pour une biodiversité riche. Les opposants, parmi eux des associations écologistes, chasseurs et syndicats sylvicoles, dénoncent la menace d’une fragmentation des habitats naturels, qui compromettrait la faune locale et la régénération sylvestre.
En parallèle, les pompiers du département ont tiré la sonnette d’alarme. Les précédents incendies de 2018 dans des parcs solaires du Sud-Ouest rappellent que l’implantation de panneaux au milieu d’une forêt présente un risque nouveau — la propagation du feu peut s’amplifier. Ce paradoxe entre production d’énergie verte et risque accru d’incendies suscite un débat passionné. Pourtant, les promoteurs mettent en avant des mesures concrètes : replantation du double de la surface déboisée, création de corridors écologiques, et intégration de systèmes de stockage à grande échelle pour sécuriser l’approvisionnement. Reste à savoir si ces garanties techniques suffiront à faire évoluer la réglementation et calmer les inquiétudes.
Un frein réglementaire inattendu : la loi Zéro Artificialisation Nette (ZAN)
Le cœur du blocage réside dans cette loi ambitieuse mais rigide, qui fait absolument de la préservation des sols non urbanisés une priorité nationale. Limiter à 25 hectares le défrichement destiné aux installations solaires, c’est vouloir freiner l’étalement urbain et conserver les espaces naturels. Une intention louable qu’aucun amoureux de la nature ne pourrait contester. Cependant, cette mesure a un effet direct déstabilisateur sur des projets de grande envergure comme Horizeo, qui demandait à empiéter largement sur la forêt.
Le gouvernement, par la voix de Michel Barnier en novembre 2024, a évoqué un possible « assouplissement pragmatique » avec une exemption de cinq ans réservée à l’industrie solaire. Mais en dépit des promesses, aucune réforme concrète ne s’est matérialisée à ce jour. La proposition de loi TRACE, adoptée en première lecture au Sénat en mars 2025, a laissé entrevoir une possible exclusion des projets renouvelables du calcul d’artificialisation, mais sa validation finale reste incertaine.
Dans ce contexte, Engie et Neoen multiplient les appels au gouvernement. Le PDG de Neoen, Xavier Barbaro, avait déjà tout prêt en juin 2025, y compris les zones dédiées au reboisement. Sans les autorisations, ce gigantesque chantier risque fort de stagner indéfiniment. Voilà une illustration parfaite des tensions entre volonté politique, exigences environnementales et aspirations industrielles, un carré d’équilibre difficile à atteindre où la France tarde à s’imposer face à ses voisins européens.
L’équilibre fragile entre transition énergétique et conservation forestière
Il faut comprendre que le défi va bien au-delà du simple dossier administratif. Les zones forestières comme la forêt des Landes jouent un rôle majeur dans la capture de CO2, la protection des sols, et l’équilibre hydrique régional. Or, chaque hectare déboisé, même temporairement, perturbe cet équilibre. La crainte des écologistes est que Horizeo ne devienne un précédent autorisant par la suite d’autres « coupes » énergétiques dans des espaces sensibles.
Les défenseurs du projet, de leur côté, insistent sur la circularité et la compensation écologique. Ils ambitionnent un modèle vertueux où l’énergie solaire ne soit pas synonyme de destruction, proposant par exemple des mesures compensatoires qui dépassent largement les zones impactées. Dans ce bras de fer écologique, les associations telles que Solarcoop et Urbasolar, engagées dans des projets solaires plus petits, observant avec attention les décisions politiques, craignent que ce frein retarde l’ensemble du secteur.
Sans parler des entreprises comme Voltalia, Reden Solar ou Solaire Direct qui doivent composer avec un cadre juridique encore trop restrictif. Le solaire, en tant qu’énergie d’avenir, a besoin d’un terrain de jeu réglementaire fluide et adapté, surtout à l’heure où d’autres nations accélèrent leurs investissements. La France, avec un potentiel solaire remarquable, se prive aujourd’hui d’un levier puissant.
Pourquoi l’Europe devance la France dans la production solaire à grande échelle
Le contraste saute aux yeux. Pendant que Horizeo reste dans les limbes, des parcs gigantesques sortent de terre en Allemagne, au Portugal et en Espagne, souvent sans aides publiques. La centrale solaire de Witznitz, en Allemagne, a atteint 605 MW en 2024, déployée sur 500 hectares avec une réalisation express en moins de deux ans. Le Portugal, lui, se prépare à inaugurer la centrale Fernando Pessoa, qui culminera à 1 200 MWc, devenant la plus puissante d’Europe, capable d’alimenter près de 430 000 foyers.
L’Espagne n’est pas en reste, avec la centrale Francisco Pizarro déjà opérationnelle à 590 MWc depuis 2022, et plusieurs autres mastodontes en projet en Andalousie. Ce dynamisme n’est pas un hasard : une réglementation plus souple, des procédures administratives rapides, et une culture industrialo-énergétique très mûre jouent à plein. Résultat, des signaux forts sont envoyés à des acteurs comme Akuo Energy ou Solarcoop, qui multiplient les projets mais regrettent la lenteur administrative française.
Conséquence : la France accumule un retard qui pourrait se creuser. Chaque mois perdu dans le traitement des dossiers éloigne un peu plus l’ouverture du parc Horizeo, pourtant annoncé pour 2026 avec une énergie propre et à bas coût. Dans un monde qui ne pardonne pas les hésitations face au changement climatique, ne pas accélérer revient à s’exposer à des dépendances renouvelées, énergétiques et économiques.
Horizeo, un pari économique et industriel inédit
Sur le plan financier, Horizeo représente une aventure hors norme : un budget de 600 millions d’euros basé uniquement sur des contrats de vente directe d’électricité avec des grandes entreprises, sans recourir à des subventions publiques. Un modèle économique qui valorise les économies d’échelle, puisque développer un site unique de 800 MW reviendrait environ 7 % moins cher que multiplier les petites centrales.
Ce pari entrepreneurial illustre que le solaire français est désormais mature. Quand TotalEnergies, Engie ou EDF Renouvelables rassemblent leurs expertises sur de tels projets, ils démontrent la robustesse économique et technique du secteur. Mais chaque mois de blocage sape la confiance des investisseurs, repousse la signature des contrats, et complexifie la rentabilité programmatique.
Le projet résume à lui seul les débats essentiels : faut-il privilégier la transition énergétique et l’urgence climatique, quitte à impacter temporairement le paysage forestier ? Ou bien maintenir une rigidité environnementale qui freine des projets vitaux pour l’indépendance énergétique ? Les écologistes craignent un précédent ouvrant la porte à des coupes dans des forêts précieuses, tandis que les promoteurs veulent donner un coup d’accélérateur à une filière clé pour la France de demain.
Une question brûlante qui ne trouve pas encore de réponse claire, le sort du plus grand parc photovoltaïque d’Europe dépendant toujours d’une décision gouvernementale. Face à des acteurs aguerris comme Voltalia et Urbasolar, la France se trouve donc à un tournant ; soit elle franchit ce cap, soit elle reste distancée dans la course solaire.
Pour découvrir d’autres avancées dans le domaine des centrales solaires françaises, il est utile de s’intéresser aux dernières inaugurations comme celle de la centrale solaire de Candate ou aux projets en cours détaillés sur des sites spécialisés. L’avenir de l’énergie solaire en France passe par ces décisions cruciales, et chaque éclaircie réglementaire pourrait changer la donne.
Quant aux secteurs moins imposants mais tout aussi stratégiques, des initiatives comme le parc solaire de Saumur ou la ferme solaire en Haute-Loire montrent l’efficacité d’un déploiement à taille plus humaine, mais qui participe pleinement à la transition.
Passionné par les énergies renouvelables, j’ai 27 ans et je consacre ma carrière à promouvoir l’énergie solaire. Mon objectif est de rendre cette source d’énergie propre accessible à tous, tout en contribuant à la protection de notre planète. Je crois fermement en un avenir durable et en l’innovation technologique pour y parvenir.